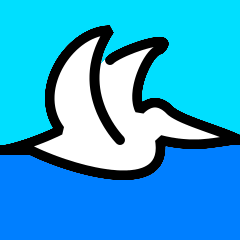Avant, le printemps, j’aimais ça. Je gambadais dans le jardin, m’amusais avec les fleurs, observais les oiseaux, les différenciais même à partir de 5 ans, et surtout, rapidement, nommais les animaux. Il y avait Gilbert le ver de terre, Cédille la chenille, Jojo l’escargot, Zanzange la mésange…
Et puis un jour, Zanzange la mésange rencontra Cédille la chenille. Bien sûr, moi, avec mes yeux d’enfant, je pensais que les deux animaux allaient danser ensemble derrière une musique à l’eau de rose, avec des papillons multicolores qui jouent du violon en arrière-plan… Au lieu de quoi, Zanzange dévora la chenille sans demander son reste. Il serait peu dire que je fus choqué. Éternellement traumatisé serait plus adapté, et encore. Depuis ce jour, le printemps n’étais plus une aubaine ni une énorme fête : plutôt un mauvais moment qui rappelait des horribles souvenirs, comme la mésaventure de Cédille. On avait beau me dire « Jack, viens voir les fleurs ! Jack, vient prendre l’air ! Jack, vient partir en balade ! » … rien n’y faisait : je restais dans mon lit à lire L’espion à la tulipe ou à faire d’autres activités tout aussi sédentaires.
Mais une nuit, le 3 mai à exactement 4h57 et 19 secondes, je ressentis une soudaine envie de sortir dehors. J’essayai de me rendormir, en vain, réessayai, utilisai plusieurs techniques de sophrologie, bus une bonne tasse de tisane, comptai les moutons, observai une conférence sur le néolibéralisme, la méritocratie et plein d’autre jargons aussi incompréhensibles que difficiles à mémoriser, mais rien n’y fit, le printemps m’appelait encore et encore à plein poumon. À l’aube, je finis par céder et sortis dans le jardin. Une atmosphère lugubre y régnait, mais j’étais résigné à trouver ce qui me tracassait tant et continuai vers le fond du potager pour finir dans les bois, hors de la maison. Mu par l’instinct, je m’orientai vers une cabane que je n’avais jamais remarquée auparavant, une vieille chaumière en bois digne d’un conte de fée. J’ouvris la porte (qui, bien évidemment, grinçait), et observai le cabanon qui n’avait rien, c’est le moins qu’on puisse dire, d’une ambiance printanière. Je fis quelques pas et finis par remarquer qu’il était vide. À mon grand étonnement, j’étais plus déçu que rassuré mais retournai en arrière en laissant derrière moi cette histoire loufoque. Mais quand je ressortis, je me retrouvai nez à nez avec un vieil homme qui devait faire une bonne soixantaine d’années, avec dans sa main un panier rempli de grosses aubergines. J’eus peur que, sous l’effet de la surprise, il se mette à manier ses légumes façon batte de base-ball, mais au lieu de quoi, il me tendit la main en articulant un « bonjour ! » jovial.
— Euh… Bonjour… Monsieur.
— Tu ne me connais pas ?! Enfin, à vrai dire, moi non plus. (Il éclata de rire.) Je m’appelle Gédéon.
Je dus me retenir de rire en entendant le prénom, puis m’en voulus immédiatement : c’était une réaction que je détestais.
— Moi, c’est Jack. Vous êtes… euh… qui ?
— On me surnomme des fois le psychologue, ou le poète.
— Le poète ? Je croyais que les poètes parlait en alexandrins !
(Il éclata (encore) de rire.)
— La vie n’est pas un stéréotype ! Bien, si tu es venu ici, c’est sûrement que tu as un problème. Je suis maintenant plus psychologue que poète, mais comme « le psychologue » sonnait mal, on a décidé de nommer cette histoire par mon deuxième surnom. Tu es sûr de ne pas avoir, je ne sais pas, de… phobie ?
— Non.
— D’hypersensibilité ?
— Non.
— De traumatisme ?
Ma voix se fit plus hésitante.
— N… Non.
Il m’observa.
— De vécu, disons, déroutant ?
— N… Oui.
L’épisode de Cédille me noua la gorge.
— Ah ! J’en étais sûr ! (Il se mit à sautiller) Je le savais ! Je le savais ! Bien, reprit-il de sa voix aiguë.
Qu’est-ce que c’était ?
Je lui expliquai tout.
— Hummm… Comment tu nommais les animaux ?
— Souvent c’était des noms de personnes que j’appréciais. Par exemple, Jojo, c’était un ami d’école. Gilbert, c’est mon oncle.
— Hummm… Et pourquoi tu étais triste lorsqu’elle est morte ?
— Ben… C’était mon amie. Enfin… je la pensais comme mon amie. Et elle a disparu.
— Mais elle n’est pas partie ! La mort ne fait pas disparaître ! Regarde ! s’exclama-t-il en pointant un vermisseau sur un tronc, c’est sûrement un descendant de ta Cédille ! Et cette feuille, ajouta-t-il en montrant une pousse à moitié mangée, elle a peut-être été croquée par elle aussi ! Chaque être vivant, des plus énormes séquoias aux minuscules lombrics, laisse une trace ! Et puis, la vie est comme un arbre, chaque automne, il faut bien qu’il y ait des feuilles qui tombent, des gens qui meurent…
— Je comprend pourquoi on t’appelle le poète.
— Merci. Bref, tu vois ? C’est bizarre, mais la mort, c’est la vie. Il faut accepter ceci. Et c’est bien normal d’être triste, même très triste, sauf que si ça va jusque t’enfermer dans ta maison pendant tout une saison… C’est quand même beau, le printemps, faut en profiter ! Et puis, c’est dur de se détacher de quelque chose une fois qu’on s’y est attaché, mais le plaisir d’avoir trouvé ton asticot dépassait la tristesse de l’avoir perdu, n’est-ce pas ?
— Oui…
— Super ! Si ça va mieux, tu peux partir, j’espère le moral remonté, pour retrouver les joies du printemps ! La vie est belle !
Sur ce, il me ferma la porte au nez (ce que j’aurais pu trouver impoli s’il ne m’avait pas à l’instant ôté des épaules un fardeau émotionnel), ne me laissant plus que le choix de partir.
Curieusement, je me sentais beaucoup mieux. La douceur printanière revenait vers moi comme pour dire « profites-en ! Viens partir en balade ! » et j’obtempérai, plus du tout embêté par le printemps. Il n’y avait rien en moi qui avait changé, pourtant : j’étais juste redevenu moi-même. Je me remis à sortir dehors. Je me remis à observer les oiseaux. Je me remis à regarder les fleurs. Je me remis même à nommer les animaux, mais en acceptant leur mort. Et même, un jour, lorsque je sauvai un hérisson trop imprudent sur la route (une longue histoire), lorsqu’il partit, tranquille, entre les fourrés…
… je l’appelai Gédéon.